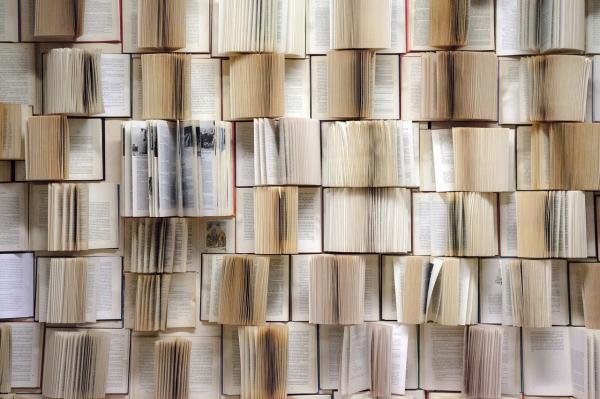Sommaire du numéro
Genres et enjeux de légitimation
Audrey GarciaReposant sur l’établissement de contrastes qui permettent de dégager des traits distinctifs pertinents, l’activité classificatoire se trouve au cœur des processus d’élaboration des savoirs. En littérature et plus généralement dans les arts, c’est la notion de « genre » qui sert à opérer un ensemble de discriminations indispensables au travail de conceptualisation de divers pans de la production culturelle.
Lire la suiteProduits culturels, modèles génériques : fusion ou friction ?
"Her Body, Himself" de Carol Clover et la figure de la Final Girl : une généalogie contestable
Florent ChristolSous-genre du cinéma d’horreur s’organisant thématiquement et visuellement autour d’un groupe de victimes décimées par un mystérieux tueur masqué, le slasher film remporta un très grand succès auprès du public adolescent de la fin des années 1970 jusqu’au milieu des années 1980. Outre son succès commercial, le slasher a surtout marqué l’histoire du cinéma pour avoir été au centre d’un débat sur la violence dans les médias.
Lire la suiteObsolescence de genres classiques et émergence de nouveaux genres populaires en contexte de « participatory culture » ?
Sylvie Périneau-LorenzoLa fécondité se reconnaît par la progéniture, et non par les honneurs. Alexandre Grothendieck (Le Monde, 4 mai 1988). Même si certains des genres dits « classiques » de l’audiovisuel se trouvent représentés sur les plates-formes des pures players ou les sites de fans, à travers des courts-métrages ou des clips par exemple, la production sur Internet génère ses propres codes. Faut-il penser que c’est un mouvement d’obsolescence naturel, à l’instar d’une décadence des formes qui, hormis dans la brièveté, ne rencontreraient plus...
Lire la suite"Sale comme une image" : couvertures, généricité et sexuation par les choix iconiques ?
Isabelle-Rachel CastaComme nous invitent à le constater tant Jean-Marie Schaeffer dans Qu’est-ce qu’un genre littéraire ? que Gérard Genette dans Seuils, la légitimité générique d’une œuvre, « ressentie » par le lecteur et/ou le spectateur, émane d’une collection variable de signes (graphiques, picturaux, éditoriaux, auctoriaux…) qui informent le récepteur sur ce qui l’attend et impliquent de la part de l’auteur le respect d’un code ; un contrat de lecture, auquel contribue le paratexte, « zone non seulement de transition mais de transaction », produit une conduite...
Lire la suiteDu genre à la généricité. Prolégomènes à une poétique du roman de la route québécois
David LaporteConfronté à un phénomène observable, l’être humain procède naturellement à une combinaison d’opérations cognitives qui tend à le rattacher à un ensemble partageant des caractéristiques similaires. Par ce travail de mise en série, il se dote d’un outil dont la dimension associative s’effectue aussi sur la base de critères discriminants, afin de parvenir à un principe de récurrence qui peut être par la suite codifié ou institutionnalisé. C’est là un geste élémentaire de la pensée que d’organiser en catégories à...
Lire la suiteContre ou au-delà du roman graphique ? La bande dessinée contemporaine face à ses délimitations
Côme MartinDéfinir ce qu’est un roman graphique s’avère, en 2016, une tâche tout aussi ardue (sinon impossible) que de définir ce qu’est ou n’est pas la bande dessinée. Thierry Groensteen l’exprime clairement dans sa note sur le sujet pour le site Neuvième art : « Le graphic novel cesse très vite d’obéir à une quelconque définition stable. Les dimensions des livres varient, l’impression en noir et blanc n’est pas un critère, le genre pas davantage puisque les super-héros ne tardent pas à investir le...
Lire la suiteDe l'usage des genres : auteurs, critiques, éditeurs et bibliothèques
Introduction et enjeux de la littérature pour jeunes adultes dans le paysage éditorial français
Violaine BeyronLa littérature de jeunesse est toujours soumise au contexte de sa production et de sa réception. En cela, il semble que les caractéristiques constitutives de l’œuvre – l’intrigue, la construction des personnages, le discours – ne peuvent être considérées indépendamment de son destinataire supposé. Concernant la littérature pour jeunes adultes, l’enjeu premier est de tenter de déterminer l’étendue du public visé, parallèlement au public adolescent, déjà largement visé par l’édition jeunesse et qui ne semble par conséquent pouvoir être exclu...
Lire la suiteDu genre comme principe légitimant : romans policiers et critiques littéraires
Fabienne SoldiniLongtemps associé à un genre populaire qui s’opposerait à la littérature savante, considéré comme une sous-littérature, le roman policier fait aujourd’hui l’objet d’un procès de légitimation, montrant ainsi comment le regard social porté sur un genre littéraire se modifie. Le genre est une notion mixte, qui peut être définie de façon interne, c’est-à-dire en tenant compte des « règles du genre », en fait des procédures d’écriture et des thématiques communes à un ensemble d’œuvres et de façon externe en faisant intervenir...
Lire la suiteLe roman policier en bibliothèque : institutionnalisation et légitimation d’un genre littéraire
Cécile RabotQuoiqu’il constitue une catégorie hétérogène où se côtoient des sous-genres différents (roman à énigme, thriller, espionnage, roman noir, policier historique, etc.) et des perspectives opposées (pôle commercial sans prétention littéraire vs. pôle plus intellectuel, à l’image du champ littéraire tel que le décrit Pierre Bourdieu), le polar constitue un genre bien identifié avec des collections spécifiques et des codes narratologiques et visuels propres. Il s’agit donc moins d’interroger la classification de livres comme polars que le classement dont le genre...
Lire la suiteMarcel Pagnol et la légitimation du genre scénaristique : vers une nouvelle forme de pièce de théâtre
Marion BrunLe scénario n’est pas considéré comme un genre littéraire, ni comme un objet artistique. Genre – s’il en est un – délégitimé par excellence, il se définit généralement comme un objet transitoire, qui fait passer une œuvre du virtuel à la réalisation. Dès lors, le geste de publication du scénario, l’avènement de cet objet préparatoire en livre, est emblématique d’une volonté de renversement de la valeur, en le proposant comme genre littéraire autonome. Marcel Pagnol édite les textes de ses...
Lire la suiteÉvolutions des genres dans l'Histoire des arts
Réinventer la peinture d’histoire au XVIIIe siècle et la stratégie des femmes pour légitimer leur place dans l’Art
Perrine VigrouxDepuis sa fondation en 1648 l’Académie royale de peinture et de sculpture juge supérieure à toute autre peinture la représentation de sujets historiques, mythologiques ou religieux. En 1667, dans la préface des Conférences, Félibien définit le grand peintre comme celui qui parvient à mêler l’histoire et la fable : « il faut représenter les grandes actions comme les Historiens, ou des sujets agréables comme les Poëtes ». La peinture d’histoire, auréolée de prestige, a pour obligation de répondre à trois...
Lire la suiteGenres et sous-genres picturaux en France du temps de l’Académie royale de Peinture : le cas de la peinture animalière
Loreline PelletierQuelle que soit l’incompréhension contemporaine devant la hiérarchie des genres, toute lecture correcte de la peinture ancienne suppose qu’on la garde présente à l’esprit. Antoine Schnapper, « Peinture – Les Catégories » , Encyclopaedia Universalis France, version numérique, 2015. Ces mots d’Antoine Schnapper témoignent de l’importance de la hiérarchie des genres pour l’étude de l’art des XVIIe et XVIIIe siècles. Récemment les historiens de l’art ont voulu réhabiliter le rôle de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, élaborant un propos contraire...
Lire la suiteLe portrait dans la France des Lumières : entre dénonciation et légitimation d’un genre pictural
Elodie CayuelaÀ l’époque moderne, l’idée d’une hiérarchie entre les genres picturaux est relativement fréquente. Une œuvre figurant un épisode historique, biblique ou encore mythologique est en effet souvent préférée et valorisée par les théoriciens de l’art. Les autres sujets picturaux – portrait, paysage, scène de genre, peinture animalière et nature morte –, parfois désignés comme « genres mineurs » ou « talents particuliers », sont quant à eux rapidement évoqués dans la littérature artistique et assez peu mentionnés pour montrer la grandeur et la...
Lire la suiteActes de la journée doctorale "Work in Progress"
L’espace exalté dans le théâtre urbain d’Ernest Pignon-Ernest
Karin Wackers-EspinosaNé à Nice en 1942, Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien, vit et travaille à Paris. Dès 1962, à partir d’événements politiques et sociaux qui continuent d’ébranler la planète, il dessine au fusain des figures de poètes, d’hommes et de femmes de la rue et les colle dans les espaces publics pour proclamer son engagement politique, éthique et esthétique. S’il ne signe jamais ses œuvres, son coup de crayon permet aisément de l’identifier. Les street artistes de renommée internationale – Banksy, JR...
Lire la suitePratiques et représentations du lieu dans La Prisonnière du désert de John Ford
Fabien MeynierDans La Prisonnière du désert de John Ford, deux récits sont représentés qui peuvent rentrer en contradiction. Le premier organise la fiction, celle d’Ethan Edwards et de ses compagnons à la recherche de la jeune Deborah enlevée par les Comanches. Une chasse à l’homme de plusieurs années à travers l’Ouest américain permettra de ramener la jeune fille devenue femme au sein de la communauté. Le second récit représenté par le film est celui des déplacements de plusieurs personnages dans le...
Lire la suiteÉcrire pour la rue
Mathilde Marcel« La production théâtrale ou plutôt la mécanique de création » connaît un renouveau dans les années soixante-dix. Le refus de diffuser une culture et un langage attribués à la classe dominante et le souhait de rencontrer et d’échanger avec un nouveau public, « conduit certaines équipes théâtrales à ne plus concevoir la représentation comme transposition d’un texte préalablement écrit », à rejeter le pouvoir des auteurs et des metteurs en scène et à adopter un mode de production collectif similaire à...
Lire la suite